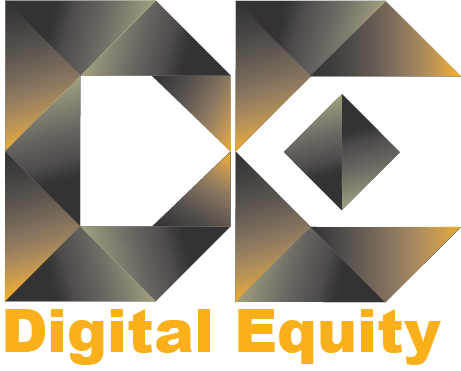Pertinence de la création d'une réserve en Bitcoin par l'État français, en s'appuyant sur une stratégie audacieuse.
1. Contexte initial et hypothèse de départ
Au 1ᵉʳ janvier 2019, le Bitcoin valait 3 352,69 €, et le budget dépenses de l'État français était de 463 milliards d'euros.
Si l'État avait alloué 5 % de ce budget (soit 23,15 milliards d'euros) à la constitution d'une réserve en Bitcoin, il aurait pu acquérir 6 904 903,23 BTC.
En 2024, avec un prix actuel estimé à 96 800 € par Bitcoin, cette réserve vaudrait 668,39 milliards d'euros.
2. Bilan hypothétique : une transformation des finances publiques
Couverture intégrale des dépenses actuelles :
Le budget dépenses de 2024 est de 453 milliards d'euros.
La réserve en Bitcoin couvrirait ces dépenses à hauteur de 147 %, éliminant tout besoin de financement par emprunt.
Élimination du déficit budgétaire :
Le déficit de 2024, estimé à 141 milliards d'euros, serait non seulement comblé mais largement excédentaire.
L'État disposerait de fonds supplémentaires pour des investissements structurels ou une réduction de la dette publique.
3. Les bénéfices potentiels pour les finances publiques
Réduction de la dette publique :
En 2019, la dette publique française s'élevait à environ 2 380 milliards d'euros (98,1 % du PIB).
En utilisant les bénéfices générés par la réserve Bitcoin, l'État aurait pu réduire significativement cette dette et donc les charges d'intérêts associées.
Stabilisation économique :
Une réserve en Bitcoin pourrait servir de fonds de stabilisation pour soutenir l'économie en période de crise, évitant de recourir à des politiques d'austérité ou à un endettement excessif.
Effet d'entraînement sur l'économie :
L'investissement de l'État dans Bitcoin aurait pu stimuler la recherche et l'innovation dans le secteur des actifs numériques en France, attirant des capitaux et des talents dans le pays.
La constitution d’un pôle de minage utilisant les surplus d’électricité aurait positionné la France sur la carte mondiale.
La création d’un stable coin européen aurait fait de la France un acteur majeur dans le secteur.
4. Les risques associés à l'époque
Bien que les chiffres soient éloquents, il est important de reconnaître les risques qui existaient en 2019 :
Volatilité élevée du Bitcoin :
En 2018, le Bitcoin avait perdu plus de 80 % de sa valeur par rapport à son pic de 2017. L'achat en 2019 aurait pu être perçu comme un pari risqué. Madame Lagarde et Monsieur Lemaire ne me contredirons pas.
Acceptation institutionnelle limitée :
En 2019, Bitcoin était encore largement considéré comme un actif spéculatif, avec peu de reconnaissance dans les cercles institutionnels ou gouvernementaux.
Problèmes de liquidité :
Acquérir une telle quantité de Bitcoin aurait pu provoquer une augmentation soudaine des prix et réduire la liquidité sur le marché. Un achat échelonné est souhaitable pour éviter une variation brutale des cours.
5. Conclusion : une opportunité manquée ?
L'allocation de 5 % du budget de l'État en 2019 à une réserve en Bitcoin aurait aujourd'hui transformé les finances publiques françaises en offrant :
Une couverture complète des dépenses actuelles.
Une élimination du déficit budgétaire.
Une marge financière substantielle pour réduire la dette publique et investir dans des projets d'avenir.
Cependant, à l'époque, les risques perçus liés à la volatilité et au manque de maturité des marchés des cryptomonnaies rendaient une telle décision difficilement envisageable.
En 2024, avec une meilleure acceptation institutionnelle et une reconnaissance croissante des actifs digitaux comme réserve de valeur, l'idée d'une réserve en Bitcoin mérite d'être revisitée. Une allocation stratégique (même modeste) dans ce type d'actifs pourrait offrir des bénéfices substantiels à moyen et long terme pour les finances publiques.